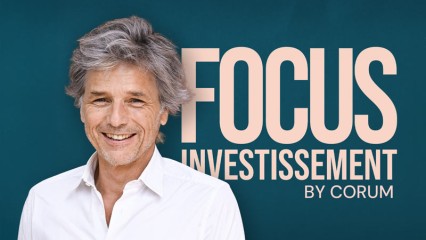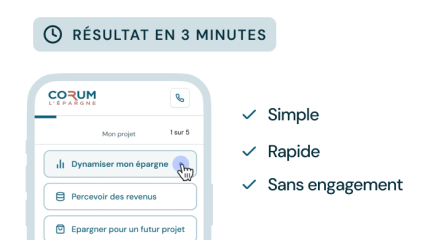Le capital des SCPI : fixe ou variable
 Temps de lecture: 6 minutes
Temps de lecture: 6 minutes Je concrétise mon projet d'épargne.
Contactez-nous du lundi au samedi,
de 9h à 19h au 01 23 45 67 89
En bref
Le capital d’une SCPI structure l’investissement, conditionne la revente de vos parts et influence vos rendements.
- Le capital d’une SCPI représente les fonds collectés pour acquérir des biens immobiliers.
- Il est divisé en parts, que les investisseurs (les épargnants) achètent pour percevoir des revenus potentiels issus des loyers.
- Le capital peut être fixe (accès limité, revente des parts sur le marché secondaire) ou variable (entrée/sortie souples mais non garanties).
- Le prix des parts évolue selon la valeur du patrimoine immobilier et les conditions de marché.
- Des hausses ou baisses du capital peuvent survenir selon les décisions de la société de gestion.
- La liquidité est faible : investir en SCPI demande une vision long terme.
Comprendre le fonctionnement du capital d’une SCPI permet d’investir avec discernement et de mieux sélectionner sa SCPI.
Le marché immobilier collectif peut offrir des opportunités intéressantes pour les investisseurs souhaitant diversifier leur portefeuille. Dans ce contexte, les Sociétés Civiles de Placement Immobilier (SCPI) se positionnent comme une solution accessible, permettant de profiter des rendements liés à la gestion immobilière, sans les contraintes opérationnelles qu'implique l'achat direct de biens. Mais avant de se lancer dans ce type de placement, il est vivement conseillé de bien comprendre la structure du capital d’une SCPI, pour évaluer ses avantages, ses risques et ses spécificités. En somme, pour mieux comparer les SCPI entre elles.
-
2. Qu’est-ce que le capital d’une SCPI ?
Le capital d’une SCPI correspond à l’ensemble des sommes collectées par la société de gestion auprès des investisseurs lors de la souscription de parts. Ce capital est ensuite utilisé pour l’acquisition de biens immobiliers (immeubles de bureaux, commerces, logements, etc.), dans le but de générer des revenus locatifs.
Chaque investisseur devient associé de la SCPI en achetant des parts. Ces parts représentent une fraction du capital total, et donc indirectement une part du patrimoine immobilier détenu par la société. Plus le montant investi est élevé, plus l’investisseur détient de parts et touche une part proportionnelle des loyers perçus, après déduction des frais de gestion.
Attention : contrairement à une assurance vie ou à d'autres produits financiers plus liquides, le capital d’une SCPI n’est ni garanti dans son montant ni dans sa durée. Il peut évoluer à la hausse ou à la baisse, en fonction des opérations de cession ou d’acquisition et de la stratégie de gestion adoptée par la société.
Il est également important de bien distinguer le capital de la SCPI de son patrimoine immobilier :
- Le capital reflète les fonds investis par les épargnants,
- Le patrimoine correspond à la valeur de l’ensemble des biens immobiliers détenus. Cette valeur évolue en fonction des marchés immobiliers, des taux d’occupation des immeubles, et des conditions de crédit et de financement.
Investir dans une SCPI, c’est donc placer son argent dans un cadre collectif, en acceptant une certaine forme de risque : perte en capital possible, revenus non garantis, et liquidité limitée. Ce type de placement immobilier reste cependant attractif pour les investisseurs en quête de diversification, de rendement potentiel et d’un accès indirect aux marchés immobiliers, sans devoir gérer eux-mêmes les biens.
3. Capital fixe vs capital variable : deux modèles à connaître
Il existe différents types de SCPI. Selon leur structure juridique, leur stratégie de gestion et leur mode de fonctionnement, le capital peut être fixe ou variable.
SCPI à capital fixe
Une SCPI à capital fixe dispose d’un montant de capital déterminé à l’avance. Cela signifie que la souscription de nouvelles parts n’est possible que lors d’opérations spécifiques : une augmentation de capital, décidée par la société de gestion, ou via le marché secondaire, où les investisseurs peuvent vendre leurs parts à d’autres épargnants.
Sur ce marché secondaire, le prix des parts est fixé librement en fonction de l’offre et de la demande. Il peut donc être supérieur ou inférieur à la valeur de référence, ce qui peut présenter à la fois des avantages et des risques.
Ce système implique une liquidité plus limitée : la cession des parts peut prendre du temps, surtout si les conditions de marché immobilier sont tendues.
En contrepartie, une SCPI à capital fixe offre généralement une meilleure visibilité sur la valorisation des biens immobiliers, ce qui peut intéresser les investisseurs souhaitant un placement plus structuré dans le temps.
SCPI à capital variable
Les SCPI à capital variable sont aujourd’hui les plus courantes. Dans ce modèle, la société de gestion peut émettre de nouvelles parts en continu, dans la limite d’un plafond de capital fixé dans les statuts. La souscription est donc ouverte à tout moment, ce qui facilite l’investissement pour les épargnants et le développement du parc immobilier de la SCPI .
Le prix des parts est déterminé par la société, souvent en lien avec la valeur de reconstitution du patrimoine. Cela octroie une plus grande stabilité du prix, même si celui-ci peut évoluer dans le temps en fonction des performances de la SCPI, des marchés immobiliers, et des frais liés à l’acquisition des immeubles.
En cas de revente, les investisseurs adressent une demande de retrait à la société de gestion, qui ne peut procéder au remboursement que si un autre investisseur se présente pour acheter ces parts, ou si la SCPI dispose d’une trésorerie suffisante. Il existe parfois une "file d’attente", ce qui implique un délai non garanti. La liquidité reste donc relative, même dans un modèle à capital variable.
4. Comprendre l’impact du capital pour l’épargnant
À l’achat : savoir ce que vous payez
Lors de la souscription de parts dans une SCPI, l’investisseur doit s’intéresser à certains critères financiers comme le prix d’achat, la valeur de reconstitution du patrimoine immobilier, ou encore les frais liés à l’acquisition. Un prix trop éloigné de la valeur réelle des actifs peut augmenter le risque de perte en capital, surtout si les marchés immobiliers évoluent défavorablement.
Les documents fournis par la société de gestion - notamment le bulletin trimestriel, le rapport annuel ou la fiche d’information - donnent une vision claire du capital de la SCPI, des investissements réalisés et du rendement historique (même s’il ne présage pas du rendement futur).
À la revente : vigilance sur la liquidité
La revente des parts de SCPI n’est pas aussi simple qu’avec d’autres placements financiers :
- Dans les SCPI à capital fixe, il faut passer par le marché secondaire, ce qui peut entraîner un délai et une négociation du prix.
- Dans les SCPI à capital variable, le rachat est possible, mais dépend de la présence d’un autre investisseur ou de la trésorerie disponible dans la société de gestion.
Il n’existe donc aucune garantie de liquidité immédiate, ni de montant récupérable à la revente. En période de tension sur les marchés immobiliers, le capital peut être temporairement bloqué ou ajusté à la baisse, affectant la valeur des parts. Ce risque doit être anticipé. Rappelons-le : les SCPI sont des placements à long terme.
Le capital d’une SCPI est un peu le cœur vivant du placement, qui évolue avec les marchés immobiliers, les décisions de gestion et les flux de souscription. C’est donc en comprenant ses mécanismes, ses formes (fixe ou variable) et ses impacts concrets, que chaque investisseur peut mieux évaluer les risques, les rendements et la durée adaptée à son projet. Tout l’enjeu : choisir un placement adapté à ses objectifs et sa situation.
Ces guides peuvent vous intéresser :