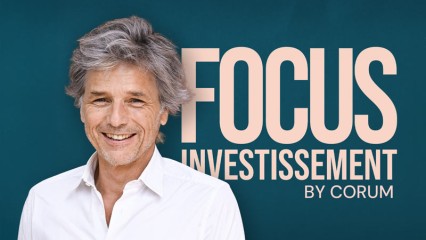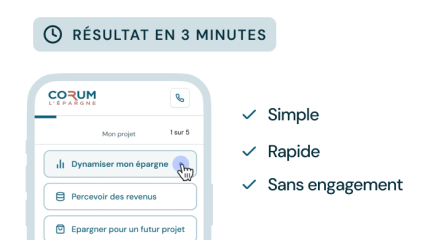SCPI – Le risque de perte en capital
 Temps de lecture: 12 minutes
Temps de lecture: 12 minutes Je concrétise mon projet d'épargne.
Contactez-nous du lundi au samedi,
de 9h à 19h au 01 23 45 67 89
En bref :
Les SCPI sont souvent présentées comme un moyen d’investir dans l’immobilier et de percevoir des revenus potentiels sans avoir à se soucier de la gestion de l’immeuble. Mais comme tout investissement, les SCPI comportent aussi des risques et inconvénients importants, à commencer par la perte en capital :
- Le prix des parts peut baisser si la valeur des biens immobiliers détenus diminue.
- Lors de la revente, rien ne garantit que l’investisseur récupérera l’intégralité de son argent.
- Les revenus issus des loyers ne sont pas non plus garantis et peuvent varier selon la conjoncture.
- Les SCPI ne sont pas facilement revendables : la liquidité est limitée.
- Il existe également des frais, un délai de jouissance et une fiscalité à bien prendre en compte.
- Ce placement doit être envisagé sur le long terme, avec une vraie stratégie de diversification.
Les SCPI sont une solution d’investissement prisée par de nombreux épargnants. En permettant d’accéder à l’immobilier via l’achat de parts, ces dernières offrent un potentiel de revenus réguliers à long terme. Mais comme tout placement, les SCPI comportent aussi des risques, notamment le risque de perte en capital.
-
2. Comment fonctionne une SCPI ?
Une SCPI, ou Société Civile de Placement Immobilier, est une solution d’investissement qui permet à des épargnants d’accéder indirectement au marché de l’immobilier. Contrairement à un achat en direct, l’investisseur acquiert des parts de SCPI, qui elle-même utilise les fonds collectés pour acheter, gérer et valoriser un parc de biens immobiliers : bureaux, commerces, logements ou établissements spécialisés.
Ces investissements sont mutualisés, ce qui signifie que le capital des investisseurs est réparti sur un ensemble de biens immobiliers. Cette stratégie favorise une certaine diversification du portefeuille, élément essentiel pour limiter l’impact potentiel de la baisse de valeur d’un bien spécifique.
Chaque SCPI est gérée par une société de gestion agréée (en contrepartie de frais), qui prend en charge la sélection des actifs, la gestion des locataires, l’encaissement des loyers et la redistribution éventuelle des revenus sous forme de dividendes.
L’un des attraits principaux des SCPI est la perception de revenus potentiels, issus de la distribution des loyers encaissés. Ces revenus ne sont cependant pas garantis. La performance du placement dépend de la qualité de gestion, du taux d’occupation, du contexte économique, mais aussi des frais liés au produit. Ces frais, qui peuvent porter sur la souscription, la gestion ou la revente, doivent être pris en compte dans l’évaluation globale du rendement.
Une SCPI fonctionne sur le long terme. Lors de l’achat de parts, il faut souvent attendre une période appelée délai de jouissance (quelques mois) avant de percevoir les premiers dividendes. Cela signifie que l’argent investi ne génère pas de revenus immédiats. En contrepartie, l’objectif est de bénéficier, sur la durée, d’un rendement stable, tout en diversifiant son patrimoine.
Il est alors important de noter que les épargnants n'ont pas de maitrise de gestion : ils délèguent entièrement la stratégie à une société spécialisée. Cela peut être vu comme un confort pour certains investisseurs, mais représente également un risque à considérer.
Ainsi, investir dans une SCPI revient à confier son argent à une société de gestion, dans l’espoir que les revenus issus de l’immobilier seront distribués régulièrement, avec un rendement cohérent face aux risques pris.
3. Qu’est-ce que le risque de perte en capital ?
Lorsqu’un épargnant place son argent dans une SCPI, il achète des parts de société qui investit dans des actifs immobiliers. Ces parts ne bénéficient d’aucune garantie en capital. Cela signifie que leur valeur peut évoluer à la hausse, rester stable ou diminuer avec le temps, en fonction de nombreux facteurs liés à la conjoncture, à la gestion, ou encore au marché immobilier. Ce phénomène est ce qu’on appelle le risque de perte en capital.
Contrairement à certains placements bancaires sécurisés, les SCPI sont des véhicules d’investissement exposés aux réalités du marché immobilier. Le prix de revente des parts peut donc être inférieur au prix d’achat initial, surtout si la revente intervient à un moment où le marché est en recul ou si la SCPI rencontre des difficultés de gestion ou de valorisation de son patrimoine.
Ce risque est structurel : il fait partie du fonctionnement même de ce type d’investissement. En détenant une fraction d’un portefeuille d’actifs immobiliers, l’investisseur accepte de s’exposer aux aléas de ce marché, y compris les baisses potentielles de valeur. C’est pourquoi les SCPI doivent être envisagées dans une logique de long terme.
La perte en capital peut aussi survenir lors de la revente des parts, notamment si la demande est faible ou si la société de gestion est contrainte de réévaluer le prix des parts à la baisse. Dans certains cas, les parts peuvent même rester invendues pendant une période plus ou moins longue, en raison d’un manque de liquidité.
En parallèle, les revenus non garantis constituent une autre réalité importante. Les dividendes versés dépendent des loyers effectivement perçus, du taux d’occupation des immeubles, des charges et des frais, ainsi que de la stratégie de distribution adoptée par la SCPI. Aucune performance passée ne peut présager d’un rendement futur.
4. Pourquoi cette perte peut-elle se produire ?
Le risque de perte en capital en SCPI peut découler de plusieurs éléments liés à la nature même du placement, à la gestion des biens immobiliers, et aux conditions économiques ou financières.
L’évolution de la valeur du patrimoine immobilier de la SCPI
Le patrimoine immobilier détenu par une SCPI est composé d’actifs variés : bureaux, commerces, logements, établissements de santé, entre autres. La valeur de ces biens n’est pas figée. Elle dépend de nombreux paramètres comme l’état du marché, la demande locative, ou encore les conditions de financement.
La société de gestion fait procéder à des évaluations régulières de son portefeuille, par des experts indépendants. Si la valeur de l’immobilier baisse, cela peut impacter le prix des parts. C’est une conséquence naturelle du marché, qui reflète la réalité économique. Or, cette situation peut avoir un impact direct sur la valeur du capital détenu par les investisseurs.
Les conditions de marché
Les SCPI sont exposées aux évolutions des marchés immobiliers, qui peuvent connaître des cycles de hausse ou de baisse. Ces variations sont influencées par divers facteurs comme le niveau des taux d’intérêt, la croissance économique, ou la politique monétaire.
Lorsque les conditions deviennent moins favorables, certains actifs peuvent se valoriser moins vite que prévu ou même perdre de la valeur. Cela affecte la performance globale du placement. De plus, un ralentissement du marché peut aussi rendre la revente des parts dans de bonnes conditions plus difficile, surtout en période de faible demande.
Liquidité limitée
Contrairement aux actions cotées, les SCPI ne sont pas échangeables en temps réel sur un marché boursier. Cette faible liquidité signifie qu’un investisseur peut devoir attendre pour revendre ses parts, surtout si le nombre de vendeurs dépasse le nombre d’acheteurs.
Ce manque de liquidité peut conduire à des délais plus longs de revente, voire à des ajustements à la baisse du prix de retrait proposé. Ce phénomène s’observe notamment lors de périodes de tension sur les marchés ou lorsque de nombreux épargnants souhaitent retirer leur argent simultanément.
Autres facteurs
Outre la conjoncture ou la liquidité, d’autres éléments peuvent aussi peser sur la valeur des parts. Parmi eux : le taux d’occupation des immeubles, la qualité des locataires, la durée des baux, la localisation des actifs ou encore l’efficacité de la gestion.
Un bien mal loué, mal entretenu ou situé dans une zone en perte d’attractivité peut générer moins de loyers, voire devenir un poids pour la SCPI. Ces situations peuvent entraîner une baisse des revenus, et par effet de chaîne, un affaiblissement du rendement et du capital.
Pour les SCPI investies dans des actifs immobiliers à l’étranger, le risque de change peut également s’avérer significatif. Les revenus perçus en devises étrangères sont susceptibles de fluctuer en fonction de l’évolution des taux de change avec l’euro. Ainsi, une dépréciation de la monnaie locale par rapport à l’euro peut réduire le rendement versé à l’investisseur, voire entraîner une moins-value lors de la revente des parts. À l’inverse, une appréciation peut être favorable, mais il s’agit d’un facteur difficile à anticiper et hors du contrôle de la société de gestion.
Enfin, il ne faut pas négliger les frais inhérents à ce type de placement. Les SCPI induisent des frais d’acquisition (frais de souscription), des frais de gestion annuels, et parfois des frais de cession en cas de revente. Ces coûts, prélevés par la société de gestion, viennent diminuer le rendement net perçu par l’investisseur. Il est donc essentiel de bien les identifier et de les intégrer dans le calcul de la rentabilité prévisionnelle du placement.
5. Comment appréhender ce risque ?
Investir dans une SCPI, comme dans tout placement immobilier, suppose d’accepter une part de risques. En réalité, il ne s’agit pas d’éliminer le risque de perte en capital (car ce n’est pas possible), mais de mieux le comprendre, de l’anticiper et de l’intégrer dans une stratégie patrimoniale cohérente. Voici plusieurs leviers pour aborder cet investissement avec plus de prudence et d’efficacité.
Se projeter sur le long terme
Une SCPI n’est pas un placement court terme. Le capital engagé est destiné à rester investi pendant plusieurs années, afin de laisser à la société de gestion le temps de faire fructifier les actifs. En moyenne, un horizon d’investissement d’au moins 8 à 10 ans est recommandé pour lisser les effets des cycles immobiliers et absorber les coûts liés à l’achat des parts.
En conservant ses parts dans la durée, l’investisseur donne au placement le temps de générer des revenus issus des loyers, et éventuellement de bénéficier d’une revalorisation progressive du prix des parts si le marché évolue favorablement. Il faut cependant garder à l’esprit que les revenus non garantis peuvent varier au fil du temps.
Lire les documents d’information
Avant toute souscription, il est essentiel que les épargnants consultent les documents réglementaires mis à disposition par la société de gestion. Ces supports détaillent les objectifs de la SCPI, sa stratégie d’investissement, sa politique de distribution, ainsi que les risques associés.
On y retrouve notamment des mentions sur le risque de crédit, le risque de devise, les frais, la durée conseillée de détention, ou encore le délai de jouissance, c’est-à-dire la période entre l’achat des parts et la perception des premiers dividendes.
Ces documents offrent un rapport clair sur la gestion passée et permettent d’évaluer la cohérence entre l’investissement envisagé et le profil de l’investisseur. Il est donc indispensable de les lire attentivement pour prendre une décision éclairée.
Diversifier son patrimoine
Comme tout placement, une SCPI ne doit pas représenter la totalité d’un portefeuille. La diversification est l’un des meilleurs moyens de limiter l’impact d’un imprévu. Cela passe par l’investissement dans plusieurs SCPI ayant des stratégies, des secteurs ou des zones géographiques différents, ou dans plusieurs types de placements.
Un investisseur peut également diversifier ses supports, en plaçant une partie de ses parts en SCPI via un contrat d’assurance vie, un PER ou en direct. Cette répartition permet d’optimiser la fiscalité et de répartir les risques.
De plus, la diversification peut aussi protéger contre des aléas de gestion : si une société rencontre des difficultés ou fait des choix moins pertinents, l’impact sur le capital de l’investisseur sera moins fort s’il détient des parts dans d’autres structures.
Se faire accompagner
Enfin, les épargnants ne sont pas seuls face à ces décisions. Il est fortement recommandé de consulter un professionnel de l’investissement, comme un conseiller en gestion de patrimoine, un notaire ou un expert du secteur immobilier. Ces interlocuteurs peuvent aider à évaluer le niveau de risque acceptable, la pertinence d’une SCPI dans votre stratégie patrimoniale, et le bon dosage entre rendement espéré et exposition au marché.
Investir dans une SCPI permet d’accéder au marché immobilier de manière indirecte, avec un potentiel de revenus réguliers. Mais comme tout placement, il comporte des risques, notamment celui de perte en capital. Les parts ne sont pas garanties, les rendements peuvent varier, et la liquidité reste limitée. Les SCPI doivent donc s’envisager sur le long terme, dans une logique de diversification du patrimoine. Il est essentiel que chaque investisseur comprenne bien les mécanismes, les frais, les délais et les inconvénients et risques des SCPI, avant tout engagement.