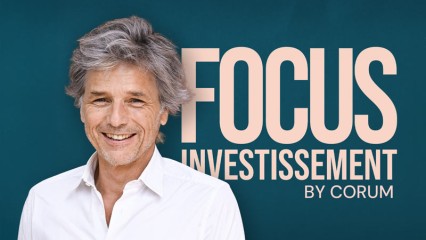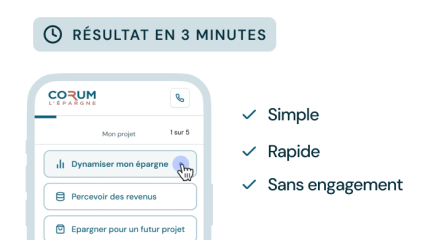Épargne salariale et retraite
 Temps de lecture: 11 minutes
Temps de lecture: 11 minutes Contact & Connexion
Contactez-nous du lundi au samedi,
de 9h à 19h au 01 23 45 67 89
En bref :
En France, de nombreux salariés peuvent profiter de dispositifs comme le PEE, le PERCO ou le PER pour se constituer une épargne à moyen ou long terme. Ces plans peuvent servir à préparer sa retraite ou réaliser d’autres projets :
- La participation et l’intéressement versés par l’entreprise peuvent y être placés.
- L’employeur peut compléter vos versements grâce à un abondement.
- Le capital peut être récupéré à la retraite, ou avant dans certains cas (achat de résidence principale, PACS, etc.).
- Vous choisissez la gestion de votre placement : sécurisée ou plus dynamique.
- Une fiscalité spécifique s’applique sur les sommes retirées, selon le dispositif choisi.
Préparer sa retraite est un projet essentiel. Dans ce but, l’épargne salariale représente un levier accessible à de nombreux salariés en France. Grâce aux dispositifs comme le PEE, le PERCO ou le PER, les entreprises offrent à leurs employés des solutions concrètes pour placer leur capital dans un cadre fiscal spécifique.
Découvrez tout sur les placements pour préparer sa retraite.
-
2. Qu’est-ce que l’épargne salariale ?
L’épargne salariale est un dispositif mis en place par les entreprises pour aider les salariés à se constituer une épargne dans un cadre fiscal et social spécifique.
Définition et principes
Dans le cadre de l’épargne salariale, les versements issus de l’intéressement ou de la participation peuvent être placés sur un PEE ou un PERCO, selon les choix offerts par l’employeur. Le capital est alors bloqué pendant une durée de cinq ans (PEE) ou jusqu’au départ à la retraite (PERCO), sauf en cas de déblocage anticipé prévu par la loi (achat de la résidence principale, mariage, PACS, naissance, ou problèmes de santé). Ces plans sont encadrés par des règles strictes définies au niveau national, en France, pour garantir un certain niveau de transparence et de protection des salariés.
L’épargne salariale concerne aussi bien les grandes entreprises que les PME, avec un accès qui tend à se démocratiser, bien que des inégalités subsistent selon la taille du groupe et les secteurs d’activité.
Avantages de l’épargne salariale
Le principal avantage de ces dispositifs réside dans la contribution de l’employeur, souvent sous forme d’abondement, qui vient compléter les versements du salarié. Cet abondement peut atteindre jusqu’à trois fois le montant versé par le salarié, dans les limites fixées par la loi.
La fiscalité est également spécifique : les sommes placées dans le cadre d’un PEE ou d’un PERCO sont exonérées d’impôt sur le revenu (hors prélèvements sociaux), à condition de respecter la durée de blocage. De plus, les plans permettent de choisir parmi différents supports d’investissements, permettant une gestion adaptée au profil de risque de chaque salarié.
Guide à lire : Quel est l’intérêt des abondements des employeurs pour préparer sa retraite ?
Inconvénients et points de vigilance
Malgré ses avantages, l’épargne salariale comporte aussi des points de vigilance. Les sommes investies, en particulier dans des supports en unités de compte, peuvent présenter un risque de perte en capital. Il est donc essentiel de bien comprendre les supports proposés dans les plans, et d’adapter son placement à ses projets (achat de résidence principale, départ à la retraite, etc.) ainsi qu’à sa tolérance au risque.
Le blocage des fonds pendant plusieurs années peut également freiner certains salariés, surtout si leurs projets nécessitent une sortie anticipée non prévue par la loi. Enfin, notez que tous les salariés n’ont pas accès aux mêmes dispositifs : certaines entreprises ne proposent pas de plan d’épargne, ou ne versent pas d’intéressement ou de participation, ce qui peut créer certaines disparités.
3. Le Plan d’Épargne Retraite (PER) : un outil clé depuis 2019
Le Plan d’Épargne Retraite (ou PER) est un dispositif créé par la loi Pacte de 2019 pour simplifier et harmoniser l’épargne dédiée à la retraite. Il vient compléter les autres plans d’épargne salariale comme le PEE ou le PERCO, avec une vocation claire : aider les salariés à se constituer un capital ou une rente en vue de leur départ à la retraite, dans un cadre souple et incitatif. Aujourd’hui, de nombreuses entreprises proposent ce dispositif, souvent en complément d’un PERCO ou dans un nouveau plan appelé PERECO.
Les différentes formes de PER
Il existe trois types de PER, chacun répondant à des situations différentes :
- Le PER individuel (ou PERIN) : accessible à tous, salariés ou non, il permet de faire des versements volontaires pour se constituer une épargne retraite personnelle.
- Le PER d’entreprise collectif (ou PERECO) : proposé par les entreprises, il est souvent alimenté par la participation, l’intéressement, les versements volontaires et les abondements de l’employeur. Il remplace progressivement le PERCO.
- Le PER d’entreprise obligatoire (ou PERO) : il est réservé à certains salariés ou à l’ensemble du personnel, avec des versements obligatoires, fixés par contrat ou accord d’entreprise.
Ces plans sont transférables entre eux, ce qui permet une plus grande liberté et une meilleure lisibilité pour les salariés tout au long de leur carrière, notamment s’ils passent dans différents groupes ou entreprises.
Fonctionnement général
Le PER permet de faire des versements volontaires, de recevoir l’abondement de l’employeur, ou d’y transférer les avoirs d’anciens contrats (comme un PERCO, un PERP ou un contrat Madelin). Les sommes placées sont bloquées jusqu’à la retraite, mais des cas de déblocage anticipé sont prévus, bien que strictement encadrés par la loi et soumis à justificatifs.
À la sortie, le salarié peut récupérer son capital en une ou plusieurs fois, ou choisir une rente, selon son besoin. Cette souplesse est d’ailleurs un des points forts du dispositif.
Les supports d’investissements proposés dans les PER sont variés (fonds en euros ou/et unités de compte). Le choix peut se faire en gestion pilotée, avec une évolution automatique des placements selon l’âge, ou en gestion libre, selon les préférences du salarié.
Fiscalité
Le PER repose sur une fiscalité spécifique. Les versements volontaires peuvent être déduits du revenu imposable dans la limite d’un plafond défini chaque année, ce qui permet à l’épargnant de réduire son imposition, tout en plaçant son argent pour la retraite.
À la sortie, la fiscalité varie en fonction de la nature des versements (volontaires, participation, intéressement, etc.) et du mode de sortie (capital ou rente). Il est donc essentiel de bien se renseigner, ou de se faire accompagner par des experts.
Mode de sortie | Nature des versements | Imposition |
Rente
| Versements volontaires déduits | Imposition à l’IR (Impôt sur le revenu) + prélèvements sociaux sur le montant total de la rente |
Versements volontaires non déduits | Prélèvements sociaux uniquement sur le montant total de la rente | |
Participation/Intéressement | Imposition à l’IR + prélèvements sociaux sur le montant total de la rente | |
Capital
| Versements volontaires déduits | Imposition à l’IR + prélèvements sociaux sur la part des gains |
Versements volontaires non déduits | Prélèvements sociaux uniquement sur la part des gains | |
Participation/Intéressement | Imposition à l’IR + prélèvements sociaux sur la part des gains |
4. Choisir les supports de son épargne salariale
Dans le cadre d’un plan d’épargne salariale ou d’un Plan d’Épargne Retraite (PER, PERCO, PERECO), bien choisir où placer son capital est une étape essentielle. En effet, les salariés disposent aujourd’hui d’un large éventail de supports d’investissements. Ces choix doivent être adaptés à leurs projets, à leur horizon de retraite et à leur profil d’épargnant. N’hésitez pas à solliciter l’accompagnement d’un professionnel pour mettre en place une stratégie personnalisée.
Les types de supports d’investissement
Dans un PEE, un PERCO ou un PER, les sommes issues de l’intéressement, de la participation, des versements volontaires ou de l’abondement de l’employeur peuvent être placées sur différents types de supports :
- Fonds euros : ils garantissent le capital investi (hors frais de gestion) et offrent un placement sécurisé. Toutefois, leur rendement est généralement plus faible.
- Unités de compte : ces investissements peuvent être plus dynamiques, avec un potentiel de performance plus élevé, mais aussi un risque de perte en capital. Ils peuvent inclure des actions, des obligations, des fonds thématiques, ou de l’immobilier.
- FCPE (Fonds Communs de Placement d’Entreprise) : spécifiques à l’épargne salariale, ils permettent aux salariés de placer leur argent dans des portefeuilles de titres gérés collectivement. Ces fonds peuvent intégrer les titres de l’entreprise elle-même, notamment dans les grands groupes.
Ces supports sont accessibles en gestion libre (le salarié choisit lui-même où placer ses avoirs) ou en gestion pilotée, où des experts ajustent les placements selon l’âge et l’horizon de retraite, avec une sécurisation progressive à l’approche du départ.
Comprendre son profil d’épargnant
Avant de choisir un support, chaque salarié doit réfléchir à son profil et à ses projets :
- Quel horizon de placement ?
- Quelle appétence au risque ? Préfère-t-il la sécurité du capital, ou peut-il accepter une certaine volatilité pour espérer de meilleurs rendements ?
- Quels objectifs ?
Les réponses à ces questions orienteront le choix du salarié vers des supports de placement différents. Par exemple, un salarié avec un horizon de placement long et une forte appétence au risque pourrait privilégier les unités de compte, espérant un rendement élevé malgré la volatilité. En revanche, un salarié proche de la retraite et préférant la sécurité pourrait opter pour des fonds euros, qui garantissent le capital investi (hors frais de gestion)
L’importance d’une information claire
Pour faire des choix éclairés, il est indispensable de s’informer. Chaque dispositif, qu’il s’agisse d’un PEE, d’un PERCO ou d’un PER, est accompagné de documents réglementaires, et notamment du DIC (Document d’Informations Clés), qui présentent les caractéristiques du placement, ses risques, ses frais et ses perspectives de rendement.
5. Les bonnes pratiques pour bien gérer son épargne salariale et retraite
Vérifier l’existence d’un plan dans son entreprise
La première étape consiste à se renseigner sur les dispositifs d’épargne salariale existants dans son entreprise. Certaines entreprises proposent un PEE, un PERCO ou un PERECO, voire un PER pour préparer sa retraite. Ces plans sont souvent accompagnés d’un abondement de l’employeur, ce qui représente une véritable opportunité d’augmenter son capital sans effort supplémentaire.
Épargner à son rythme
L’épargne salariale est souple : les versements volontaires sont généralement libres, ce qui permet aux salariés de s’adapter à leur situation financière, à leurs priorités et à l’évolution de leurs revenus.
En plaçant régulièrement, même de petites sommes, les salariés profitent de l’effet de capitalisation sur le long terme, ce qui peut constituer un capital significatif au moment de la retraite. De plus, dans certains plans, les versements peuvent être mensuels et automatiques, ce qui facilite la régularité. Dans tous les cas, il est judicieux de commencer à épargner pour la retraite le plus tôt possible.
Ne pas investir sans comprendre
Avant de placer son argent dans un plan d’épargne salariale ou un PER, ainsi que pour toute autre d’épargne, il est essentiel de comprendre les caractéristiques des dispositifs, leurs modalités de fonctionnement, les risques associés aux supports d’investissements (en particulier les unités de compte), ainsi que les conditions de sortie.
Lire les documents d’information, se former grâce aux simulateurs proposés sur les sites publics (AMF, service-public.fr, économie.gouv.fr), ou poser des questions à son employeur ou à des experts sont des réflexes importants.
De même, il est primordial d’être attentifs aux frais de gestion et aux performances passées (sans oublier que celles-ci ne préjugent pas des performances futures.
Se faire accompagner si besoin
Les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) ou les Conseillers en Investissements Financiers (CIF) jouent un rôle clé dans l’accompagnement des épargnants. Ces professionnels ont pour vocation d’offrir des conseils personnalisés et une information claire. Grâce à leur expertise, ils sont en mesure d'analyser la situation financière et les objectifs de vie de leurs clients pour proposer des solutions d’épargne et de placement optimisées. Leur connaissance approfondie des dispositifs, des avantages fiscaux et des tendances du marché leur permet ainsi de choisir les supports d’investissement les plus appropriés et d’en maximiser le rendement tout en minimisant les risques associés. En se faisant accompagner par un CGP ou un CIF, les épargnants bénéficient d’une gestion sur mesure de leur épargne salariale et de leurs plans de retraite.
L’épargne salariale et les plans de retraite sont bien plus que de simples dispositifs financiers : ce sont de vraies solutions pour construire, semaine après semaine, un capital utile à un projet de vie. Toutefois, n’oubliez pas l’essentiel : bien s’informer, ne pas précipiter ses choix, et adapter ses placements à son profil.
Ces autres sujets peuvent aussi vous intéresser :