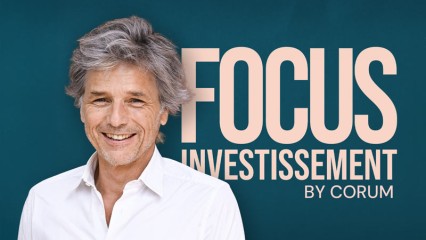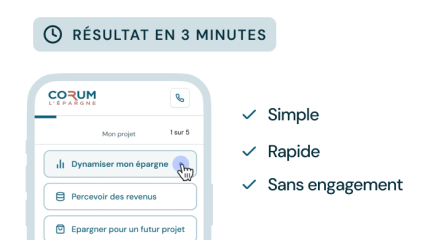Pourquoi anticiper l'imposition à la retraite ?
 Temps de lecture: 10 minutes
Temps de lecture: 10 minutes Je concrétise mon projet d'épargne.
Contactez-nous du lundi au samedi,
de 9h à 19h au 01 23 45 67 89
En bref
Anticiper l’imposition à la retraite, c’est éviter les mauvaises surprises et optimiser tant que possible ses revenus. L’essentiel à retenir :
- À la retraite, vos pensions, rentes ou capitaux sont des revenus imposables soumis à l’impôt sur le revenu et à des prélèvements sociaux.
- L’administration fiscale applique un abattement de 10 % sur les pensions, mais dans une limite annuelle à ne pas dépasser.
- Le Plan d’Épargne Retraite (PER) et l’assurance vie permettent de bénéficier d’une fiscalité spécifique, à condition de bien en connaître les règles.
- Diversifier ses sources de revenus permet d’adapter sa stratégie au fil des années et d’optimiser sa situation fiscale.
Le départ à la retraite marque un changement majeur dans la vie et la situation fiscale de chaque individu. Les revenus perçus à ce moment-là, qu’ils proviennent de pensions, de rentes ou du capital d’un contrat d’épargne, restent soumis à l’impôt. Anticiper son imposition et prendre le temps de comprendre le système fiscal permet alors d’optimiser ses versements et ses retraits, ce qui peut faire la différence sur plusieurs années.
-
2. Comprendre la fiscalité des pensions de retraite
Lorsque l’on part à la retraite, les pensions deviennent la principale source de revenus pour de nombreux foyers. Or, comme tout revenu, ces montants sont soumis à l’impôt sur le revenu, au même titre qu’un salaire perçu durant la vie active. Il est donc essentiel de comprendre comment s’organise le système fiscal appliqué à ces revenus afin de bien les anticiper dans sa déclaration annuelle.
La fiscalité des pensions de retraite repose sur un calcul effectué par l’administration fiscale, en tenant compte du montant total perçu au cours de l’année. Avant que ce montant ne soit intégré au revenu imposable, un abattement automatique de 10 % est appliqué. Cela signifie que seule une partie des pensions est effectivement prise en compte pour le calcul de l’impôt. Toutefois, cet abattement est plafonné à un certain seuil chaque année, fixé par l’administration.
En plus de l’impôt sur le revenu, les retraites sont également soumises à plusieurs prélèvements sociaux. On parle ici de la CSG (contribution sociale généralisée), de la CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale) et de la Casa (contribution additionnelle de solidarité pour l’autonomie). Les taux appliqués à ces prélèvements varient selon la situation du foyer fiscal, notamment le revenu fiscal de référence et la composition du foyer.
À ce titre, par exemple, un retraité vivant seul avec de faibles revenus peut bénéficier d’un taux réduit, voire d’une exonération partielle ou totale de certaines cotisations. À l’inverse, un foyer avec d’importants revenus de retraite, issus de rentes, de pensions complémentaires, ou encore d’un contrat d’assurance vie ou d’un PER, pourra se voir appliquer des taux standards, voire majorés.
3. Les principaux dispositifs d’épargne retraite et leur fiscalité
Pour compléter les pensions versées par les régimes obligatoires, il est courant de constituer une épargne retraite supplémentaire. Ces produits ont pour objectif de fournir un complément de revenu lors du départ à la retraite, sous forme de rente ou de capital. Comprendre leur fiscalité est indispensable pour évaluer le montant des revenus réellement disponibles une fois à la retraite.
Le Plan d'Épargne Retraite (PER)
Le PER, ou Plan d'Épargne Retraite, est aujourd’hui le principal contrat d’épargne individuel mis en avant par le service public et les entreprises pour préparer sa retraite. Créé par la loi PACTE en 2019, il remplace les anciens dispositifs comme le PERP ou le contrat Madelin et est spécifiquement dédié à l’objectif retraite.
Pendant la phase d’épargne, les versements effectués sur un PER peuvent être déduits du revenu imposable. Cette déduction fiscale est soumise à un plafond annuel, souvent égal à 10 % des revenus professionnels de l’année précédente, avec une limite maximale fixée par l’administration fiscale. Cela permet de réduire son impôt durant la vie active tout en préparant sa retraite. Toutefois, il est important de vérifier que cette stratégie soit judicieuse au regard du taux d’imposition payé à ce moment-là par l’épargnant.
Au moment de la sortie, c’est-à-dire au départ en retraite, le capital ou les rentes perçues deviennent de nouvelles sources de revenus, soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Si l’épargnant choisit de recevoir un capital, celui-ci sera imposé selon le régime des revenus imposables après abattement. En cas de sortie en rente viagère, les sommes seront soumises à un taux d’imposition variable selon l’âge au moment du premier versement.
Notez cependant que la fiscalité appliquée à la sortie du PER peut être plus avantageuse si l’épargnant a choisi de ne pas déduire les versements de son revenu imposable durant la phase d’épargne.
Il faut également savoir que certaines situations particulières, comme l’achat de la résidence principale ou la fin d’activité professionnelle, permettent une sortie anticipée du PER, avec un traitement fiscal spécifique.
L’assurance vie
Autre produit phare de l’épargne longue, le contrat d’assurance vie peut aussi être utilisé pour préparer la retraite. Bien qu’il ne soit pas dédié exclusivement à cet objectif, il permet de se constituer un capital ou une rente qui viendront compléter les pensions et les autres revenus du foyer au moment du départ en retraite.
L’assurance vie présente un cadre fiscal spécifique. Après huit ans de détention, les retraits bénéficient d’un abattement annuel sur les gains (4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un foyer). Le reste est soumis à un prélèvement forfaitaire ou à l’impôt sur le revenu, selon le choix de l’épargnant.
De plus, en cas de décès, le capital transmis aux bénéficiaires du contrat est exonéré de droits de succession dans la limite de 152 500 € par bénéficiaire (si les versements ont été effectués avant les 70 ans).
>Découvrez tout sur la fiscalité des produits d'épargne à la retraite.
4. L’impact de la fiscalité sur les revenus à la retraite
Arrivé à l’âge de la retraite, il est naturel de vouloir préserver son niveau de vie. Pourtant, le passage d’une activité professionnelle à la perception de pensions, de rentes ou d’un capital peut entraîner une modification significative de la situation fiscale. C’est pourquoi il est essentiel d’anticiper l’effet de l’imposition sur ses futurs revenus, afin d’éviter une mauvaise surprise au moment de la déclaration d’impôt.
Comme nous l’avons vu, les pensions versées par les régimes de base et complémentaires, bien que souvent moins élevées que les anciens salaires, restent considérées comme des revenus imposables. Elles sont soumises à l’impôt sur le revenu, après application de l’abattement de 10 % accordé par l’administration fiscale, dans la limite d’un plafond annuel. À cela s’ajoutent les prélèvements sociaux obligatoires, comme la CSG, la CRDS et la Casa, dont le taux dépend du revenu fiscal de référence du foyer.
De même, les rentes issues d’un PER, d’un contrat d’assurance vie, ou d’un autre produit d’épargne, sont elles aussi soumises à un calcul d’imposition spécifique.
Pour ne pas subir une fiscalité trop importante, il est essentiel d’anticiper. Cette réflexion doit être menée bien avant le départ à la retraite, car chaque décision prise en amont – en matière de versements, de choix de contrat d’épargne, ou de planification des retraits – aura un impact sur les revenus futurs, leur fiscalité, et la stabilité de la vie de l’épargnant après sa fin d’activité.
>Découvrez tout sur la fiscalité de la prime de départ à la retraite.
5. Quelles stratégies pour anticiper et optimiser l’imposition à la retraite ?
Anticiper l’imposition de ses revenus à la retraite ne consiste pas à l’éviter, mais à mieux la comprendre pour en limiter les effets négatifs.
Diversifier les sources de revenus
La première étape consiste à ne pas dépendre d’une seule source de revenus. En plus des pensions de base et complémentaires, il est souvent pertinent d’ajouter des rentes issues d’un PER, ou encore des retraits d’un contrat d’assurance vie. Chaque produit obéit à des règles fiscales différentes : en combinant plusieurs solutions, l’idée est de lisser la fiscalité dans le temps et d’utiliser au mieux les abattements prévus par l’administration.
Planifier les retraits
Le moment choisi pour effectuer un retrait peut aussi influencer directement le taux d’imposition. Par exemple, un retrait important sur une seule année peut faire passer le revenu imposable dans une tranche supérieure, augmentant ainsi le montant de l’impôt dû par le foyer. De plus, si celui-ci est effectué sur une assurance vie, il peut dépasser les abattements annuels prévus, ce qui peut priver l’épargnant de certains avantages fiscaux.
Mieux vaut souvent échelonner ses retraits sur plusieurs années, afin de rester dans une tranche plus avantageuse. De même, il peut être judicieux de différer certains versements jusqu’à une période où les autres revenus sont plus faibles.
Enfin, une bonne planification permet aussi de maximiser les abattements disponibles chaque année, et de mieux gérer les prélèvements sociaux associés aux rentes, pensions et autres sources de revenus.
Faire appel à un conseiller
Chaque situation est unique. Le taux d’imposition, le plafond des abattements, la composition du foyer, les contrats détenus, les cotisations versées au fil des années… Ce sont autant de variables qui rendent la stratégie optimale différente d’un individu à l’autre.
Un conseiller en gestion de patrimoine ou un conseiller en investissements financiers peut vous aider à établir un plan adapté. Ce professionnel prendra en compte vos revenus actuels et futurs, vos projets de retraite, vos versements programmés sur un PER ou une assurance vie, ainsi que les modalités de sortie en capital ou en rente envisagés. Il pourra aussi vous conseiller sur les déductions fiscales possibles, les bons arbitrages à faire, et le bon moment pour déclarer certains revenus.
Ce type d’accompagnement permet souvent de bénéficier d’un meilleur équilibre entre rendement, sécurité et fiscalité, tout en respectant les règles de l’administration fiscale. Tout l’enjeu ? Obtenir des recommandations personnalisées.
Préparer sa retraite, ce n’est pas seulement épargner, c’est aussi anticiper l’imposition future de ses revenus. En comprenant le système fiscal, en diversifiant ses sources de revenus, et en planifiant intelligemment ses versements et retraits, chacun peut se bâtir un plus plan solide et adapté à sa situation. C’est en étant mieux informé et bien accompagné que l’on prend de meilleures décisions.
Ces autres sujets peuvent aussi vous intéresser :