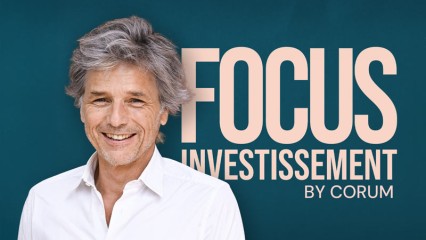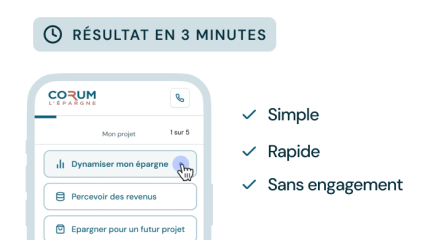La fiscalité des produits d'épargne à la retraite
 Temps de lecture: 12 minutes
Temps de lecture: 12 minutes Je concrétise mon projet d'épargne.
Contactez-nous du lundi au samedi,
de 9h à 19h au 01 23 45 67 89
En bref
Entre fiscalité spécifique à l’entrée, imposition à la sortie et règles de transmission, comprendre la fiscalité du PER et de l’assurance vie est essentiel pour bien préparer sa retraite.
Voici l’essentiel à retenir :
- Le Plan d’Épargne Retraite (PER) permet de déduire vos versements volontaires de votre revenu imposable (dans la limite d’un plafond), ce qui réduit vos impôts… mais les sommes seront imposées à la sortie, que vous optiez pour une sortie en capital ou en rente.
- L’assurance vie, elle, n’offre pas de déduction à l’entrée, mais bénéficie d’une fiscalité très dégressive après 8 ans, notamment grâce à un abattement annuel sur les plus-values.
- Le PER est bloqué jusqu’à la retraite (sauf cas exceptionnels), tandis que l’assurance vie reste disponible à tout moment.
- En cas de décès, l’assurance vie offre des conditions spécifiques de transmission.
En réalité, le bon choix dépendra de votre situation fiscale, de vos revenus, et de vos objectifs personnels.
Préparer sa retraite est un objectif de long terme qui implique des choix de placements adaptés, en tenant compte de leur fiscalité et de leurs conditions de sortie. Si de nombreuses solutions existent – comme l’épargne salariale, les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier), l’immobilier direct, les livrets, le PEA (Plan d’Épargne en Actions) ou encore le CTO (Compte-Titres Ordinaire) – ce guide se concentre exclusivement sur la fiscalité de deux dispositifs phares dans le cadre de la préparation à la retraite : le Plan d’Épargne Retraite (PER) et l’assurance vie.
-
2. Le Plan d’Épargne Retraite (PER)
Présentation du PER
Le Plan d’Épargne Retraite, ou PER, est un produit d’épargne spécifiquement conçu pour préparer la retraite. Créé par la loi PACTE en 2019, il regroupe plusieurs anciens dispositifs (PERP, Madelin, PERCO) dans un seul plan plus flexible.
Son objectif est simple : permettre aux salariés, indépendants ou épargnants individuels de constituer un capital ou une rente viagère disponible au moment de la sortie à la retraite. Le PER peut prendre différentes formes selon l’origine des versements :
- Le PER individuel (ou PERIN), ouvert à tous, avec des versements volontaires qui peuvent provenir de toute personne souhaitant préparer sa retraite de manière indépendante. Ce PER est souvent choisi par les travailleurs indépendants et les personnes sans accès à un PER d'entreprise ;
- Le PER d’entreprise collectif (PERCOL), souvent alimenté par l’épargne salariale comme l'intéressement et la participation. Ce type de plan est généralement mis en place par l'entreprise pour offrir une solution d'épargne retraite à ses employés. Les versements peuvent être réalisés par l'employeur ou l'employé, ou une combinaison des deux ;
- Le PER d’entreprise obligatoire, destiné aux salariés pour lesquels l’entreprise effectue des cotisations obligatoires. Ce plan est mis en place par certaines entreprises pour garantir une épargne retraite à leurs employés, avec des versements réguliers effectués par l'employeur.
Chaque compartiment du PER est soumis à des règles de fiscalité, de déduction ou d’imposition spécifiques.
La fiscalité des versements sur un PER
L’une des grandes particularités du PER réside dans le traitement fiscal des versements volontaires. Ces sommes peuvent être déductibles du revenu imposable, ce qui permet une réduction d’impôt. Cette déduction s’effectue dans la limite d’un plafond annuel calculé en fonction des revenus d’activité de l’année précédente. En 2025, les salariés peuvent déduire jusqu’à 10 % de leur revenu net imposable, avec un plafond global d’environ 35 194 euros. Pour les travailleurs non-salariés, un plafond distinct s’applique.
Cette déduction peut permettre une économie d’impôt immédiate, d’autant plus conséquente si l’on se situe dans une tranche d’imposition élevée. Toutefois, il est également possible de ne pas opter pour la déductibilité à l’entrée du PER, ce qui permet ainsi de bénéficier d’une fiscalité plus douce à la sortie.
Le choix entre versements déductibles ou non doit être fait avec soin, car il influence directement la fiscalité au moment du déblocage du plan.
La fiscalité à la sortie du PER
À la retraite, les droits acquis dans le PER peuvent être récupérés de deux façons :
- en capital, versé en une ou plusieurs fois ;
- en rente viagère, c’est-à-dire des paiements réguliers à vie.
La fiscalité à la sortie dépend de la nature des versements initiaux :
- Lorsque les versements volontaires ont été déduits des revenus imposables, alors les sommes perçues à la sortie (hors plus-values) sont soumises à l’impôt. Les plus-values générées sont soumises au prélèvement forfaitaire unique (PFU) ou, au choix, au barème progressif de l’impôt avec les prélèvements sociaux.
- Si les versements n’ont pas été déduits, le capital est exonéré d’impôt (hors plus-values), ce qui peut représenter un avantage dans certains cas.
En cas de rente viagère, la fiscalité est différente : la rente est soumise à l’impôt sur le revenu après un abattement calculé selon l’âge au moment du premier versement. Les prélèvements sociaux s’appliquent également sur une partie de cette rente, définie par la loi.
Points de vigilance concernant le PER
Le PER est un placement de long terme, avec des règles strictes concernant le déblocage anticipé de l’argent. Hors cas exceptionnels et strictement encadrés par la loi (décès du conjoint, invalidité, fin de droits au chômage, etc.), les sommes ne sont disponibles qu’à la retraite.
Il est donc essentiel d’adapter son plan à sa situation personnelle et à ses objectifs. Par exemple, un salarié fortement imposé peut avoir intérêt à maximiser ses versements déductibles, tandis qu’un revenu plus modeste préfèrera la souplesse d’un plan individuel sans déduction, pour éviter une charge fiscale trop élevée à la sortie.
De plus, il est aussi recommandé de porter attention à la gestion des fonds : selon les supports choisis (fonds euros ou unités de compte), les plus-values potentielles sont plus ou moins importantes, mais les risques aussi. Tâchez donc de vous informer et de choisir une stratégie en accord avec votre horizon de retraite, votre tolérance au risque et vos besoins futurs.
3. L’assurance vie
Présentation de l’assurance vie
L’assurance vie est l’un des placements préférés des Français pour préparer un projet à long terme (dont la retraite), transmettre un capital ou faire fructifier leur argent. Flexible et accessible, ce contrat permet d’effectuer des versements libres ou programmés tout au long de sa vie, avec une gestion adaptée à ses projets et à son revenu.
Contrairement au PER, avec l’assurance vie, les fonds ne sont pas bloqués jusqu’à la retraite. Il est donc possible de retirer son capital à tout moment, même si une sortie anticipée peut avoir un impact sur la fiscalité.
L’assurance vie propose généralement deux types de supports d’investissement :
- Les fonds euros, sécurisés, mais avec des rendements souvent modestes ;
- Les unités de compte (épargne en actions, en obligations ou en immobilier), plus dynamiques, mais aussi plus risquées, avec des plus-values non garanties et de possibles pertes en capital.
La fiscalité des gains de l’assurance vie en cas de rachat
Lorsque vous effectuez un rachat (retrait partiel ou total), seule la part des gains (intérêts ou plus-values) est soumise à l’imposition. Le traitement fiscal dépend principalement de la durée du contrat et du type d’imposition choisi.
Pour les contrats ouverts depuis moins de 8 ans, les gains sont soumis :
- au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 30 % (12,8 % d’impôt + 17,2 % de prélèvements sociaux) ;
- ou, sur option, au barème progressif de l’impôt sur le revenu, avec ajout des prélèvements sociaux.
Après 8 ans, un abattement annuel s’applique :
- 4 600 euros pour une personne seule ;
- 9 200 euros pour un couple soumis à imposition commune.
Au-delà de cet abattement, les plus-values restent soumises à un PFU réduit de 24,7 % (7,5 % d’impôt + 17,2 % de prélèvements sociaux) dans la limite de 150 000 euros de versements ou au barème progressif, selon l’option choisie. Au-delà de 150 000 euros, le PFU reste à 30%.
Ce traitement fiscal encourage donc à conserver son assurance vie dans la durée pour optimiser les effets de cet abattement.
La fiscalité en cas de transmission
L’assurance vie est aussi un outil de transmission patrimoniale très intéressant. En cas de décès de l’assuré, les capitaux versés aux bénéficiaires désignés ne passent pas par la succession classique.
Les règles fiscales dépendent de l’âge auquel les versements ont été effectués :
- Avant 70 ans : chaque bénéficiaire peut recevoir jusqu’à 152 500 euros en exonération d’impôts. Au-delà, un taux de 20 % puis 31,25 % s’applique selon le montant transmis.
- Après 70 ans : les versements sont soumis aux droits de succession, après un abattement global de 30 500 euros (tous bénéficiaires et contrats confondus), mais les plus-values générées restent exonérées de droits.
Points de vigilance concernant l’assurance vie
Même si l’assurance vie offre une grande souplesse, certains éléments méritent attention. Tout d’abord, les frais peuvent varier d’un contrat à l’autre (frais d’entrée, de gestion, d’arbitrage…), ce qui peut impacter la performance réelle du placement.
Ensuite, le choix des supports d’investissement doit être cohérent avec votre horizon de retraite et votre profil de risque. Les unités de compte peuvent générer des plus-values intéressantes, mais aussi des pertes en capital. Les fonds euros, quant à eux, offrent une sécurité mais avec un taux souvent inférieur.
Enfin, bien que l’argent soit disponible à tout moment, un retrait anticipé peut réduire les avantages fiscaux. Il est donc recommandé d’envisager l’assurance vie comme un placement de moyen ou long terme.
>Découvrez tout sur l'imposition des revenus locatifs à la retraite.
4. Comparaison entre le PER et l’assurance vie
Objectifs et horizons d’investissement
Le PER et l’assurance vie sont deux placements destinés à faire fructifier son argent sur le long terme, mais avec des logiques et des objectifs différents.
Le Plan d’Épargne Retraite (PER) est spécifiquement conçu pour constituer une épargne en vue de la retraite. Il propose une sortie en capital, en rente viagère, ou les deux. Son cadre fiscal est optimisé pour encourager les versements volontaires en échange d’une déduction possible du revenu imposable.
L’assurance vie, elle, est plus généraliste. Elle peut servir à préparer la retraite, financer un projet, anticiper une succession ou générer un revenu complémentaire. Elle n’impose pas d’âge ni de condition pour la sortie, ce qui la rend plus souple pour des projets à horizon variable.
è Le PER est donc idéal pour les personnes souhaitant déduire leurs cotisations de leur revenu actuel (notamment les salariés fortement imposés), tandis que l’assurance vie offre plus de liquidité en cas de besoin avant la retraite.
Fiscalités respectives
Le PER permet une déduction des versements volontaires du revenu imposable, dans la limite d’un plafond défini par la loi. Cette déduction réduit l’impôt sur le revenu dès l’année du versement. En contrepartie, lors de la sortie, les sommes récupérées sont en grande partie soumises à l’imposition, que ce soit en capital ou en rente. Les plus-values sont également soumises aux prélèvements sociaux.
L’assurance vie, quant à elle, ne propose pas de déduction à l’entrée. En revanche, elle bénéficie d’un abattement fiscal très avantageux après 8 ans de contrat : 4 600 euros d’abattement par an sur les revenus pour une personne seule, et 9 200 euros pour un couple. En plus, la fiscalité des gains peut être adoucie par le prélèvement forfaitaire unique (PFU), dégressif après 8 ans, ou le barème progressif.
Flexibilité et liquidité
Sur ce point, l’assurance vie l’emporte. L’épargnant peut demander le déblocage de son capital à tout moment, sans justification. C’est un contrat liquide, particulièrement utile en cas d’imprévu ou de besoin urgent d’argent.
Le PER, lui, est bloqué jusqu’à l’âge de la retraite, sauf cas exceptionnels prévus par la loi (achat de la résidence principale, invalidité, décès du conjoint, etc.). Il est donc moins flexible, mais cette contrainte peut être vue comme un avantage pour rester discipliné dans sa démarche d’épargne de long terme.
Transmission du patrimoine
Enfin, en matière de transmission, l’assurance vie est souvent plus avantageuse. En cas de décès, les bénéficiaires du contrat peuvent recevoir les fonds en dehors du cadre classique des droits de succession, avec un abattement jusqu’à 152 500 euros par bénéficiaire (si les versements ont été faits avant 70 ans). Ce cadre fiscal peut permettre une transmission efficace et optimisée.
Le PER, lui, ne bénéficie pas des mêmes avantages successoraux. En cas de décès avant la sortie, le traitement dépend du type de PER (individuel ou entreprise), de l'âge du titulaire au moment du décès, et des choix de sortie. Dans certains cas, les sommes peuvent réintégrer la succession et être soumises aux droits de succession, selon les règles en vigueur.
Préparer sa retraite, c’est avant tout anticiper, arbitrer, et optimiser la fiscalité de ses placements. Que vous choisissiez un PER pour bénéficier de déductions fiscales dès aujourd’hui, ou une assurance vie pour ma souplesse, la transmission et la fiscalité allégée à la sortie, chaque plan doit être pensé selon votre situation, vos revenus et vos objectifs de vie. Prenez le temps de comparer, de vous informer et, si besoin, faites-vous accompagner.
Ces autres sujets peuvent aussi vous intéresser :